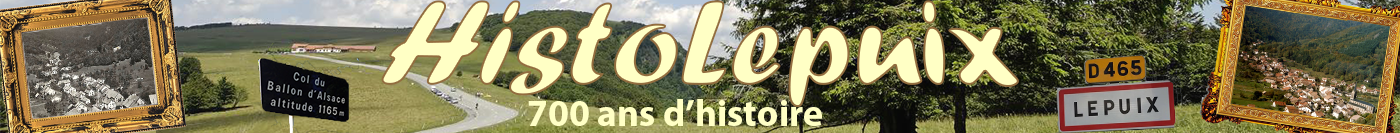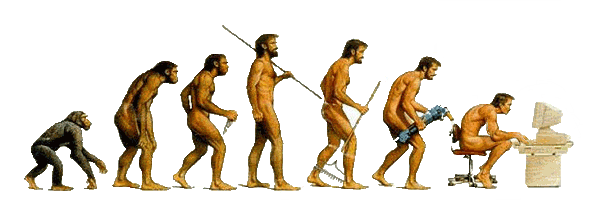Création de la terre
une pluie de météorites s’abat sur la planète. Grâce à ce phénomène, la Terre va peu à peu se composer d’eau.
Apparition végétaux
Les premières formes de vie apparaissent sur Terre il y a 3,5 milliards d’années. Il ne s’agit alors que de végétaux ; il est beaucoup trop tôt pour parler « d’animaux ».
Apparition des 1ers hommes
(début Préhistoire)
apparition des premiers ancêtres de la lignée des « hommes »
1ers hommes dans le Sundgau
Les premiers hommes s’implantent dans le Sundgau dès 500.000 ans avant Jésus Christ. Les fouilles ont révélé des vestiges des périodes paléolithique et néolithique
Invention de l'écriture
(début antiquité)
L'Antiquité commence avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie 3 500 ans.C'est la période des premières grandes civilisations qui se développèrent sur tous les continents et notamment autour du bassin de la mer Méditerranée.
Période séquane
Dans la première moitié du ier siècle av. JC., les Séquanes contrôlent un vaste territoire, la Séquanie, correspondant approximativement à l'actuelle Franche-Comté
Période romaine
Vers 70 avant Jésus Christ, les Séquanes pour se libérer du joug de leur voisin les Eduens, font appel à des mercenaires germains. Ceux ci, conduits par Arioviste, finissent par s’installer dans le territoire des Séquanes, qui pour les chasser font appel aux Romains. Jules César bat Arioviste en 58 avant Jésus Christ et les Romains dans les territoires Séquanne
Les grandes invasions dans l'empire romain
Les grandes invasions barbares du IVe au Ve siècle disloquent définitivement l'Empire Romain en renforçant dans la population un sentiment de précarité.
Les vandales (dont le nom restera synonyme de destructeur), les suèves et les alains franchissent en 406 avec environ 150000 hommes le Rhin qu’un hiver d'une rigueur exceptionnelle avait gelé en dévastant tout sur leur passage.
Les Huns sont d’une férocité abominable, et Attila semble mériter son qualificatif de « fléau de Dieu ». Attila décide d’envahir la Gaule vers le milieu du Ve siècle, il rassemble une troupe germano-hunnique de 50 000 hommes et ravage tout le nord de la Gaule
Les années 461-476 sont une débâcle pour l’Empire qui perd tout pouvoir légitime
Période Burgonde
(début moyen-Age)
Les invasions barbares cèdent la place à des guerres entre rois barbares qui profitent de l'absence de l'autorité romaine.
Le peuple burgonde, proche des Goths, vient probablement de l'île danoise de Bornholm à l'est de la pointe sud de la Suède. Ils descendirent d'abord entre la Vistule et l'Oder (Odra). A partir du 3ème siècle ils migrent vers le Main et la rive gauche du Rhin. Au 5ème siècle ils forment un royaume avec Worms comme capitale.
A partir de 522 les Burgondes subissent des incursions franques de plus en plus nombreuses.
En 524 l'un des fils de Clovis, Clodomir y perdra la vie. Cependant en 534 les Francs parviendront à leur fin, Gondomer sera tué, le royaume burgonde sera annexé au royaume francs et prendra le nom de Bourgogne.
Période Francs
La Gaule est occupée par plusieurs peuples germaniques, dont les Francs, établis entre la Meuse et l'Escaut, mais aussi sur le Rhin. Jusqu'en 476, les tribus franques se contentent de défendre l'Empire romain.
Mais, en 481, sous la conduite de Clovis, les Francs Saliens décident de conquérir le Nord de la Gaule.
Après avoir détruit le dernier îlot de résistance romaine autour de Soissons, ils battent les Alamans à Tolbiac, en 496.
Clovis parvient à se faire reconnaître par tous les Francs
Invasion des Sarrasins
Après avoir envahi l'Espagne en 711, les Sarrasins ont franchi les Pyrénées en 718 et occupèrent l'Aquitaine jusqu'à la Loire, où le chef franc Charles Martel les a arrêtés à Poitiers, en 732.
Dès 725, les Arabes ont remonté la vallée du Rhône, pillé toute la Bourgogne et détruit Autun. En 732, ils s'emparent de Luxeuil (Haute-Saône), pillent Besançon et sillonnent sans doute toute la Franche-Comté, jusqu'au seuil d'Alsace, avant d'être vaincus définitivement en 739.
Invasion des Hongres
Peuple de cavaliers, les Hongres, venus d'Asie, envahirent la plaine du Danube.
Ils devinrent alors pour plusieurs décennies, tout comme les Sarrasins, la terreur de l'Europe centrale et occidentale.
Dès 899 et surtout entre 909 et 933, des pillards hongrois pénétrèrent jusqu'au Danemark, en France, en Provence et dans les Pouilles. Ils ravagèrent aussi le Rhin supérieur.
Difficile à estimer, l'ampleur des dommages paraît avoir été exagérée dans des récits ultérieurs. Jusqu'à ce que les mesures défensives de l'Empire deviennent efficaces (dispositions de l'empereur Henri Ier sur les places fortes en 926), la protection des populations incomba aux seigneurs locaux, qui firent construire ou réparer des refuges (comme le "Chastel" de Lostorf).
Les incursions diminuèrent, puis cessèrent, après les défaites infligées par Henri Ier (bataille de Riade en 933) et Otton le Grand (Lechfeld en 955).
Création comté de Montbéliard
En 1042, l'empereur germanique Conrad II le Salique fonde le comté de Montbéliard et le donne à son vassal Louis de Mousson et de Bar qui devient le premier comte de Montbéliard d'Altkirch et de Ferrette.
Thierry II en 1125 garda le comté de Montbéliard y compris le Rosemont laissant à son autre frère Frédéric les terres de Ferrette et de Porrentruy
Thierry Ier, se maria avec Ermentrude ; fille du compte de Bourgogne en 1070. De ce mariage naquirent 9 enfants.Thierry II l'ainé en 1125 garda le comté de Montbéliard y compris le Rosemont laissant à son autre
frère Frédéric les terres de Ferrette et de Porrentruy.
Création seignerie du Rosemont
Constitution de la seigneurie par Louis de Mousson, comte de Montbéliard. C'est vraisemblablement à cette époque que fut édifié le château abritant un lieutenant représentant le comte.
Le Puy fait partie de la mairie de la Burg ou du Val.
Louis de Mousson, comte de Montbéliard, est à l'origine de la première branche des comtes de Montbéliard qui s'éteindra en 1162, de la branche des comtes de Ferrette dont le dernier descendant mâle mourra en 1324
La seignerie du Rosemont seigneurie se composait de deux parties d'inégale importance,
le Haut Rosemont et le Bas Rosemont.
Le Haut Rosemont : avec les terres d'Auxelles Haut et Bas, de Chaux, de
Giromagny ; Rougegoutte, Grosmagny, Lepuix ? Lamadeleine, Petitmagny,
Lachapelle sous Chaux, Sermamagny, Vescemont et Riervescemont.
Le Bas Rosemont : avec Argiésans, Banvillars, Meroux, Urcerey et Vézelois.
Rattachement au comté de Bourgogne
En 1162 le comté de Montbéliard (Rosemont compris) passe aux sires de
Montfaucon puissants seigneurs de Bourgogne jusqu'en 1282 époque où il échoit
à Renaud de Bourgogne apporté en dot par sa femme Guillaumette. L'autorité
du comte Renault fut éminemment libérale et apporta beaucoup d'améliorations
dans la condition de ses sujets.
Montbéliard en 1286, Belfort en 1307, obtinrent l'abolition de la mainmorte
Rattachement au Comté de Ferrette
Le comte Renaud avait un fils faible et deux filles, l'une Jeanne qui épousa en 1299 Ulrich
de Ferrette et l'autre Agnès qui épousa Henri de Montfaucon.
En 1332, un
partage eut lieu à Granges. Agnès eut la seigneurie de Granges et de
Montbéliard et Jeanne obtint Belfort et Ferrette avec le Rosemont.
De son
mariage avec Ulrich de Ferrette, Jeanne eut deux filles, Jeanne qu'on appela
Jeannette et Ursule. D'un second mariage avec Raoul de Bade, elle eut encore
deux filles, Marguerite et Adélaïde.
Rattachement à la maison d'Autriche
Les quatre filles d'Agnes se réuniront au château d'Altkirch le 26 août 1347, firent quatre parts des biens de leur mère et tirèrent au sort. Jeannette l'ainée eut les châteaux et seigneuries de Rosemont et de Salbert.
a seigneurie passe au Comté de Ferrette.
Lorsque le comte Ulrich III meurt en 1347 sans laisser d’héritier mâle, la succession se fait en ligne féminine, au profit de la Maison d’Autriche, suite au mariage du duc Albert II et de Jeanne de Ferrette.
Le traité de partage rédigé en allemand y détaille les lieux-dits de
la région : cette seigneurie se composait du château du Rosemont ; Sermamagny,Chaux, Soden (Lepuix), Giromagny, Vescemont, Rougegoutte et Grosmagny, la mairie d'Évette avec Oye (Valdoie), Eloye, Forcelon, Essert, la mairie de Banvillars avec Urcerey et Argiésans, les fiefs d'Auxelles et de Forcelon, les étangs de Chaux, les forêts de Lambert, de Chaux, de la Varrière et du Salbert.
Pillage des grands Bretons
En 1375 le sire de Coucy, petit-fils de Léopold d'Autriche voulut
revendiquer la succession de sa mère en Alsace et rassembla des bandes de
pillards au nombre de plusieurs milliers qu'on appela les Grands Bretons.
le Rosemont et les environs de Belfort auraient été pendant six semaines victimes de cette invasion
Pillage des Ecorcheurs
En 1375 le sire de Coucy, petit-fils de Léopold d'Autriche voulut
revendiquer la succession de sa mère en Alsace et rassembla des bandes de
pillards au nombre de plusieurs milliers qu'on appela les Grands Bretons.
le Rosemont et les environs de Belfort auraient été pendant six semaines victimes de cette invasion.
les paysans du Rosemont soulevés par la misère et le désespoir battirent et expulsèrent les Ecorcheurs et le pays en fut débarrassé en
mars 1445.
Hypohèque mise sur le Rosememont
Les archiducs d'Autriche n'avaient pas de revenus suffisants ils durent faire des emprunts et engager leurs biens. Ce fut le sort du Rosemont qui fut hypothéqué pour ses droits et rentes totalement ou partiellement en 1360 à Pierre de Bollwiller, en 1363 à Marguerite de Bade, en 1447 à Erkinger de Hugenhowen, en 1450 à Pierre de Morimont, en 1456 à Gunzmann de Brinighoffen, en 1457 à Rodolphe de Soultz, en 1459 à Pierre de Morimont, cela ne faisait le bonheur des habitants que les seigneurs engagistes pressuraient et exploitaient pour en tirer le maximum de revenus.
Renouvellement exemption des droits de mainmorte
Sigismond confirme aux gens du Rosemont l'exemption des droits de
mainmorte ; A la suite d'une supplique et vu le développement et dévouement "
nous leur confirmons cette franchise et grâce ainsi que tous les droits dont ils
jouissaient à perpétuité et sans entrave, comme si ces droits étaient transcrits
mot pour mot dans cette patente".
Un siècle après en 1567 l'archiduc Ferdinand renouvelle ces droits et en 1603
l'empereur Rodolphe les confirme à nouveau.
Mais les empereurs étaient loin et des franchises durent souvent être oubliées.
Hypohèque mise sur le Rosememont
En 1469 l'archiduc Sigismond vend au duc de Bourgogne Charles le Téméraire le Landgraviat d'Alsace (Ferrette et le Brisgau) pour 50.000 florins or à condition que les franchises des habitants seraient respectées et que les terres après remboursement reviendraient à l'Autriche. Charles nomme comme lieutenant Pierre de Hagenbach qui après 5 années d'administrateur laisse le plus odieux souvenir. On se révolte contre lui et on lui coupe la tête.Le duc de Bourgogne fait exercer de terribles représailles en Sundgau (Belfort et Ferrette). Sigismond rachète ses états engagés le 6 avril 1474. En 1489 Maximilien succède à Sigismond dans le Landgraviat d'Alsace et à cours d'argent il engage à nouveau en 1492 le Rosemont pour 10 ans à Gaspard de Mormons contre la somme de 25.300 florins.
Passage à la maison de Ferette
En l'an 1500 Maximilien d'Autriche cède à la maison de Ferrette le château d'Auxelles avec son enceinte et dépendances le moulin, les dîmes et 36 fauchées de prés. Cette donation est confirmée en 1521 à Conrad de Ferrette avec en plus des bois et forêts et de quelques gens propres dans le dit village d'Assel et celui de Sot (Lepuix) montant le tout à 16 familles ». Le Rosemont reste engagé en 1501. Il le fut encore en 1532 et 1534 avec supplément de 8.680 florins et la seconde fois de 14.000 florins.
Les mines
L’âge d’or des mines du Rosemont se situe entre le milieu du XVIème et le début du XVIIème siècle. L’exploitation fut intensive et les travaux s’enfoncèrent de plus en plus profondément. Au XVIème siècle, une justice spécifique aux mines s’installa à Giromagny qui prit un essor considérable.
De 1783 à 1786 les mines furent exploitées au compte du duc de valentinois par l'ingénieur Broëlman. Celui-ci délaisse les filons remplis d'eau et attaque les filons dont seule la tête était exploitée mais des travaux sont d'une désespérance lenteur.
Pendant le XiXeme siècle par trois fois on a essayé de réexploiter ces mines et d'en rouvrir les galeries. La première entreprise a été faite par une société anonyme vers 1843 sous la direction de M. Collard. Après un début assez prospère la société fit de mauvaises affaires et cessa en 1848.
Quelques années après la guerre de 1870 M. Varelle de Servance en Comté avait racheté la propriété des mines. Il y a fait travailler un an ou deux et sa mort a arrêté le travail.
En 1888 une compagnie du nord de la France a recommencé plus en grand que les deux autres fois ; elle a fait ouvrir un ancien puit à Lepuix pendant environ 4 ou 5 ans elle a aussi abandonné ces mines, le rapport n'étant pas en proportion des dépenses.
Révolte des paysans
Les paysans insurgés se plaignent de leurs conditions de vie et des abus de la noblesse et du clergé. En plus de la pression démographique, ils voient les terres communales usurpées par les seigneurs. Ils croulent sous les taxes et les corvées et veulent supprimer les derniers relents de servage.
Jean Henry met trois jours et trois nuits à rassembler son monde. Sitôt le rassemblement opéré, 500 hommes restent en réserve et 15.000 se dirigent sur Belfort.
La rencontre eut lieu aux environs du Valdoie et les gens de Belfort y furent
battus.Un mois plus tard le vendredi après la Fête-Dieu, Jehan de Morimont
annonce au régent d'Ensisheim que les insurgés conduits par un inconnu
viennent d'occuper le château d'Etueffont que tout le pays est en révolte en le
bailliage du Rosemont que la guerre est déclarée contre les nobles et les prêtres
et qu'il ne peut réprimer l'insurrection.
Peu après le ton de Morimont devint
plus hardi envers Jehan de Chaux qui était le chef de la bande insurgée. Les derniers soubresauts de la révolte se termina par l'écrasement des rebelles à Altkirch, Wattwiller, Habsheim,
Rixheim.
Jehan de Chaux, un des chefs sinon l'unique de la bande venue de Chaux la Jolie aurait été arrêté à Plombières est détenu au château de Hohenach. Il aurait correspondu avec de Morimont pour lui demander sa mise en liberté celle-ci lui aurait été refusée et il aurait été pendu.
Rachat de l'hypothèque
Ferdinand Ier racheta l'hypothèque du Rosemont vers 1534 mais tous les droits ne furent libérés que le 21 janvier 1563, jour où les archiducs entrèrent en jouissance complète de la seigneurie.
Création lieu de vente
Vers 1560, un marché fut établi à Giromagny tous les samedis pour l'approvisionnement des mineurs
Un règlement fut établi en 1562 pour déterminer exactement les attributions des seigneurs et des officiers des mineurs pour éviter les conflits.
Les ouvriers des mines sont exempts d'impôt pour leurs maisons et jouissances aux lieux qui leur sont octroyés mais s'ils font des acquisitions ou possédèrent des biens personnels, ils rentrent dans la règle commune. Ils feront bâtir 6 boucheries à Giromagny, elles seront louées à des bouchers moyennant un « cens stable et fixe ».
Constructions
En 1569 on construisit l'église de Giromagny payée un tiers par l'archiduc et les deux autres tiers par les mineurs. En 1581 la régence d'Ensisheim écrit aux officiers de Belfort au sujet des dégâts causés dans les bois du Rosemont par les possesseurs de scieries et les cuvetiers. Malgré les ordres donnés pour faire fermer ces scieries, il en restait 5 en activité dans la vallée du Rosemont et 7 dans la vallée de Lepuix et en plus 12 ouvriers cuvetiers dans les deux vallées.
La guerre de 30 ans
La Guerre de Trente Ans, qui dura ici de 1610 provoque l'effondrement de l'edifice autrichien. Dès 1619, les premiers troubles sont rapportés.
La guerre débute avec l'invasion du Sundgau par les suédois conduits par le Rhingrave Othon-Louis. Belfort tombe entre les mains des suédois en 1633 après un 1er siège avant de repasser entre les mains des Espagnols commandés par le Duc de Feria, des Suédois afin d'être finalement conquise en 1636 par Louis II de Champagne Compte de la Suze.
Il est nommé gouverneur de Belfort par Richelieu. La conquête est ratifiée par le traité de Westphalie de 1648.
Louis XIV fit don du fief du Rosemont au comte Gaspard de la Suze, fils du précédent puis, en 1659, au cardinal de Mazarin.
Le filage
En 1750 il y a déjà une grande quantité de fileurs et de fileuses dans les montagnes le subdélégué Noblat dit que Giromagny est un endroit où on file beaucoup, car les eaux blanchissent naturellement les fils et les toiles et les eaux de la montagne sont plus claires et vives, plus pures pour le blanchissage que dans la plaine
Ratachement à Monaco
Le 15 juillet 1777 Louise Félicité Victoire d’Aumont (1759-1826) épouse Honoré IV Charles Anne Maurice Grimaldi, duc de Valentinois puis prince de Monaco. Honoré de Grimaldi obtient par édit de ne pas porter le titre de duc de Mazarin et de ne pas remplacer ses armes par celles du cardinal. Belfort est désormais sous la houlette monégasque. Durant la Révolution le couple se sépare. Louise Félicité Victoire, cinquième comtesse de Belfort, est emprisonnée plus d’un an sous la Terreur et perd ses biens dont elle retrouvera une partie sous la Restauration.
Le comté de Belfort disparaît à la Révolution mais les princes de Monaco en gardent le titre. Belfort qui n’a été monégasque que durant quelques années ne dépend plus de la principauté où demeurent une part de ses archives.
Sous la révolution
La Révolution et la révocation de la donation Profitant de la convocation des États Généraux en 1789, les habitants de Grosmagny font part de leurs récriminations contre la duchesse et ses agents. Ils rédament la fin de la vénalité des offices et le retour à la situation d'avant le cantonnement de 1762.Ils s'opposent au contrôle des eaux, à la dîme sur les pommes de terre et les légumes et aux octrois. Un rapport présenté parJean-Baptiste Geoffroy, député de Saône-et-Loire, devant l'Assemblée nationale le 17 juillet 1791, propose la révocation de la donation faite au cardinal Mazarin en 1659. Le cardinal aurait présenté comme disponibles des fiefs réunis à la Couronne par les traités de Westphalie, et de ce fait inaliénables; le don serait trop important au regard de l'ensemble des terres acquises en 1648. Au nom de son épouse, le duc de Valentinois cherche à faire valoir ses droits, publiant une réponse par la-quelle il conteste les arguments du député. La donation au cardinal ne serait, selon lui, pas un fait unique et porterait sur un volume de terres rai-sonnable. Régulièrement contestée, la légalité de la donation a été confirmée à trois reprises par le Conseil d'État en 1667, 1684 et 1707 (l'autorité de la chose jugée étant conforme au décret du 1° dé-cembre 1790 sur les aliénations du domaine).
Coupant court à ce débat juridique, l'Assemblée Nationale vote, le 25 juillet 1791, le décret de révocation rattachant les biens fonciers d'Alsace au domaine public
L'assemblée nationnale annule et révoque la donation faite au Cardinal Mazarin des ci-devant Comté de Ferette et seigneurerie de Belfort Delle, Thann, Henheim, par lettre parente du mois de décembre 1159, lequels demeurent aussi révoqué comme tout ce qui s'en suivi
1er siège de Belfort
Le reflux de la Grande Armée après la retraite de Russie fut suivi de l'arrivée devant Belfort d'une division autrichienne qui investit la place de Belfort commandée par le lieutenant-colonel Jean Legrand. La ville résista pendant 113 jours dans des conditions très éprouvantes pour les habitants.
2ème siège de Belfort
le général Claude Jacques Lecourbe qui, en tant que commandant du 1er corps d'observation du Jura, dirigea la résistance de Belfort
Le 22 juin, Napoléon avait abdiqué pour la seconde fois. Les Autrichiens, dont le but était atteint et mesurant les énormes sacrifices qui seraient nécessaires pour venir à bout des Français solidement retranchés, acceptèrent le 8 juillet de signer une suspension d'armes avec le général Lecourbe. Ce cessez-le-feu se transforma en armistice à Bavilliers le 11 juillet.
3ème siège de Belfort
Pendant la guerre La guerre franco-allemande de 1870, Belfort ville est assiégée par les Allemands. La garnison de 15 000 hommes du colonel Denfert-Rochereau tient tête aux 40 000 Prussiens durant 103 jours.
En raison de cette résistance héroïque, et parce que l'arrondissement de Belfort était francophone, la moitié sud-ouest de l'arrondissement, soit 106 communes couvrant 609 km2 (avec Belfort, Delle et Giromagny, mais sans Cernay, Dannemarie, Masevaux, Saint-Amarin et Thann) n'est pas annexée par l'Allemagne, contrairement au reste du département du Haut-Rhin : les Allemands quittent la ville en 1873
Création du Territoire de Belfort
Après la première guerre Mondiale, l’Alsace-Lorraine retourne à la France, et avec elle, la question du devenir de Belfort et de son territoire. On évoque à un moment donné une nouvelle configuration de l’Alsace, avec Mulhouse comme sous-préfecture et Belfort comme Préfecture du Haut-Rhin ; les divisions politiques et l’octroi d’un statut particulier à l’Alsace-Lorraine par le gouvernement ne permettent pas la réalisation de ce projet, et le territoire n’est pas rattaché à l’Alsace-Lorraine.
De plus, l’ancienne partie allemande du Haut-Rhin et le Territoire –ancienne partie française- ont évolué différemment du point de vue social et économique. Des débats politiques violents ont lieu, dans les années 1920-21, à propos du rattachement du Territoire à l’Alsace en tant que sous-préfecture ou préfecture.
C’est finalement par le décret du 18 février 1922 que le Territoire de Belfort devient le 90e département français.